La fusillade de Nanterre
Le 27 Mars 2002, à Nanterre (92), à la suite du conseil municipal de Nanterre, un homme présent à la séance se met à tirer sur les élus. Bilan de 8 morts et de 19 blessés dont 14 grièvement.
Libération - 28/03/2002 - 1h11, salle du conseil, Durn sort son arme et tire - Par Fabrice TASSEL
Nanterre. La fusillade de la mairie de Nanterre, dans la nuit de mardi à mercredi, a fait huit morts et dix-neuf blessés
Maîtrisé par des élus, le tireur a été arrêté par la police. Toute la matinée, les politiques ont défilé sur place.
Christian et Sylvain Demercastel vont se souvenir toute leur vie de cette soirée du 26 mars. Christian est élu (vert) à Nanterre. Mercredi, à 19 heures, il prend place pour assister au conseil municipal. La ville compte 53 élus, dont certains sont absents. Juste derrière Christian, à la première des dix rangées de gradins du public, riche d'une trentaine de personnes, s'assied son fils Sylvain, la trentaine. Il se trouve à deux mètres des premiers élus, afin de pouvoir échanger quelques mots avec son père. «Il écoutait.» A côté de Sylvain, Richard Durn, vaguement connu pour avoir déjà suivi ce type de réunions. Christian Demercastel le salue, Sylvain échange quelques banalités avec Durn, qui compare cette séance à «une comédie humaine» et se demande «ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent». Durn parle brièvement avec Pascal Sternberg, autre élu vert. Au cours du conseil, long de cinq heures, Sylvain Demercastel et Pascal Sternberg sortent de la salle faire quelques pas. Durn les suit. «Il ne parlait pas, nous écoutait surtout», raconte Sylvain. Il est minuit et demi. Christian Demercastel, médecin généraliste, est fatigué. Les questions importantes ont été traitées, il décide de s'en aller. «C'est la première fois qu'il partait avant la fin, il se sentait un peu coupable», dit Sylvain, qui quitte la salle avec son père. Les deux hommes ignorent encore que cette décision leur évite peut-être la mort. Une grosse demi-heure plus tard, Jacqueline Fraysse, maire (PCF) de Nanterre, suspend les débats. Il est 1 h 10, Richard Durn est le dernier spectateur présent. Il occupe la même place qu'en début de séance, à deux mètres des élus écologistes. L'homme se lève, sort de sa parka verte un pistolet automatique 9 mm de marque Glock et tire sans sommation. Une première fois vers la tribune, où siègent le maire et ses quinze adjoints, distante d'une quinzaine de mètres. Le premier adjoint, le communiste Michel Laubier, est touché à l'épaule. «Je n'ai pas tout de suite réalisé, puis j'ai vu du sang», raconte la maire. Samuel Rijik, élu RPR, évoque aussi cet instant de latence: «J'ai d'abord cru à un très mauvais gag, je suis resté passif. Puis je me suis caché.» Dans la salle, la scène tourne à l'horreur. Durn abat, presque à bout portant, l'élu le plus proche, Sternberg, avec qui il bavardait quelques heures plus tôt, puis fait feu sur Estelle Le Touzé, autre conseillère écologiste, touchée au ventre. L'homme descend les marches des gradins et entreprend, sans cesser de tirer, de contourner l'hémicycle réservé aux élus. Il tire vers les pupitres de droite, occupés par les socialistes, puis sur sa gauche, où prennent place les élus de l'opposition. Certains sont abattus, alors qu'ils sont encore assis. «Il a tiré comme un malade, il était venu tous nous tuer», a raconté à l'AFP Emmanuelle Bobin, conseillère municipale socialiste. Richard Durn dispose de 6 chargeurs de 15 balles chacun et d'un chargeur rallongé de 26 munitions. Il tire, recharge, tire, le bras tendu, sans un mot. Une quarantaine de projectiles au total, dont la plupart font mouche. «Trois élus ont été blessés par la même balle, qui a touché le bras du premier avant de ricocher sur les deux autres», témoigne Alexis Bacheley, collaborateur du groupe socialiste. Durn tue deux élus réfugiés sous une table. D'autres rampent dans les travées vers la sortie. Confusion. «Agissant avec beaucoup de détermination, de façon méthodique», selon les mots du procureur de Nanterre Yves Bot, Richard Durn progresse vers la tribune du maire. Une chaise est lancée vers lui. Profitant de la confusion, trois adjoints - Philippe Lacroix, Jean-Pierre Campos et Laurent El Ghozi - tentent de le ceinturer. Durn extirpe alors un deuxième pistolet, de même marque que le premier, et recommence à faire feu, blessant grièvement Lacroix et Campos et plusieurs autres personnes. El Ghozi, touché dans le haut de la cuisse, tente de réanimer des collègues déjà morts. Alors que Durn glisse un nouveau chargeur dans son arme, deux autres adjoints, René Amand et Michel Laubier, parviennent à le maîtriser, puis à le désarmer. Peu avant cette intervention décisive, Samuel Rijik, après avoir senti «une balle frôler [sa] veste», est parvenu à s'échapper. Il court vers le commissariat, à une centaine de mètres de la mairie. Les policiers arrivent, interpellent Durn, qui crie alors: «Tuez-moi ! Tuez-moi !», des mots qu'il répète aux policiers dans le fourgon qui l'emmène vers l'Hôtel-Dieu, à Paris, où il subit une visite médicale avant d'être présenté au siège de la police judiciaire. Les policiers découvrent que l'homme détenait une troisième arme, un revolver 357 magnum de marque Smith and Wesson. Au total, il a tué 8 élus et en a blessé 19 autres, dont 14 gravement. Son domicile de Nanterre est perquisitionné. Les enquêteurs y découvrent les factures des armes, acquises légalement. A l'hôtel de ville, les survivants téléphonent à leurs proches, qui affluent durant toute la matinée, comme le personnel administratif. Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur, arrive sur les lieux à 3 heures, en compagnie de Jospin, qui découvre les corps des victimes gisant encore dans la salle. Chirac rejoint Nanterre à la levée du jour. «Acte de folie meurtrière», pour l'un, «drame tout à fait inimaginable», pour l'autre. Dans l'après-midi, plusieurs centaines de Nanterriens se sont recueillis devant la chapelle ardente dressée à l'hôtel de ville. Sur une table couverte d'une nappe verte reposaient les photos des huit victimes. Personne ne pouvait encore comprendre le geste de Richard Durn.
Libération - 29/03/2002 - Richard Durn, le suicide après le coup de folie
Par Patricia TOURANCHEAU
L'assassin de huit conseillers municipaux à Nanterre s'est défenestré lors d'un interrogatoire, hier à Paris.
Les circonstances de la mort du forcené suscitent une controverse sur l'attitude de la police.
Brigade criminelle. 36, quai des Orfèvres, Paris. 9 h 30. Richard Durn, 33 ans, vient de remonter avec ses gardiens les trois étages de l'escalier monumental qui mène à l'enseigne lumineuse bleue de la «crim'». Au quatrième étage, sur la droite, une mezzanine et des filets tendus au-dessus du vide. Depuis qu'en 1984, Nathalie Ménigon d'Action directe a été rattrapée in extremis alors qu'elle enjambait la rambarde. Sur la gauche, un couloir étroit, au linoléum noir. On conduit Richard Durn dans le bureau 414 du groupe V. Au fond, sous le toit en soupente, deux tables de travail, une photo des Tontons flingueurs, un dessin de Corto Maltese, la une de l'Equipe sur la victoire des Bleus en 1998. Au milieu, à 1,60 mètre du sol, un vasistas clos mais non crocheté. Contre le mur de droite, la table du lieutenant Philippe D., qui a «le feeling» avec Richard Durn, qui a su le «mettre en confiance» et «le faire parler», selon un commissaire. On lui ôte les menottes. Une chaise lui est proposée face au policier blond, un café. Porte d'entrée verrouillée. On évite aussi le face-à-face «un contre un» entre le gardé à vue et «l'interrogateur», une habitude à la crim'. Un troisième homme reste «pour surveiller»: le brigadier Patrick M. Vissé à sa machine. Philippe D. attaque la troisième audition de Richard Durn, sur ses lettres (lire ci-contre). La veille, au bout de deux interrogatoires «chaotiques» et «décousus», il a fini par expliquer ce besoin de «maîtriser» pour une fois quelque chose, de «tuer le plus de gens possible» avant de s'«éliminer» lui-même. Au début de la garde à vue, à 1 h 30 du matin, «ce n'était pas gagné». «Terriblement excité» après ses huit meurtres, ceinturé, il hurle aux policiers: «Pourquoi vous ne m'avez pas tué ?» Quand l'officier lui notifie ses droits, «Durn refuse tout, ne veut ni médecin, ni avocat», explique un policier. «On l'envoie d'office à l'Hôtel-Dieu, où un généraliste l'examine et délivre un certificat médical: "état de santé compatible avec la garde à vue".» Prostré. Le procureur de la République de Nanterre, Yves Bot, et le patron de la brigade criminelle, Frédéric Pechenard, discutent. Faut-il l'envoyer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ? Le magistrat décide de ne «pas obérer la garde à vue», parce qu'il «faut un procès pour les familles, donc un dossier judiciaire et des explications de Durn». De plus, l'homme est désormais «prostré», «éteint», «calme». Au 414, Philippe D. parvient à «établir le contact» avec Durn, à lui extirper des phrases sur son curriculum vitae, sur ses problèmes psychiques («depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours vécu dans une prison mentale dont j'étais le propre geôlier», selon le procès-verbal), sur son impuissance à trouver un travail, sur sa mission humanitaire en Bosnie en 1993 («la seule aventure de ma vie»), sur son militantisme associatif («j'avais l'impression d'être pris pour un con»). Sur son geste aussi: «J'ai voulu connaître la griserie et le sentiment d'être libre par la mort.» Vers 19 heures, mercredi, l'officier D. tape la dernière phrase du procès-verbal de Richard Durn: «Je veux mourir car je suis une chose et un déchet.» Le gardé à vue signe et part pour la nuit au «dépôt», en sous-sol. Il est 19 h 30. Le commissaire Pechenard l'accompagne et «donne des instructions orales et écrites aux gardiens»: "Instable psychologiquement, Richard Durn est susceptible d'attenter à ses jours, et nécessite une attention de tous les instants."» Fusée. Hier matin, Durn revient dans le bureau 414 et parle à l'officier D. de ses lettres. Toujours «extrêmement calme et coopératif». Le policier le questionne sur l'ultime lettre à sa mère et lui demande de se lever pour regarder le document. Il est 10 h 15. «Richard Durn est parti comme une fusée en l'air, a pris appui sur un meuble, et a plongé sur le vasistas, comme d'un plongeoir mais en sens inverse, avec une force démentielle, comme s'il voulait percuter la vitre, passer à travers, rapporte un enquêteur. Sous la poussée, le vasistas a volé, le brigadier M. a plongé derrière, a essayé de le retenir par les jambes, et a failli y passer aussi, rattrapé par l'officier D. Comme on enlève les lacets des gardés à vue, M. s'est retrouvé avec la basket gauche de Durn à la main.» Les policiers diront plus tard: «On n'est pas à Guantanamo ici, on ne met pas des chaînes aux pieds des criminels.» Le corps a glissé sur le toit en pente sur 2 mètres, a passé la gouttière, et a chuté de quatre étages sur le bitume de la cour intérieure du «36». Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, a parlé de «graves dysfonctionnements» et déclenché une enquête conjointe avec la garde des Sceaux sur ce suicide. Les policiers de la crim' défilent à l'IGS, la police des polices, sommés de dérouler la garde à vue. L'enquête judiciaire sur les «assassinats» continue, donc l'action publique n'est pas éteinte.
Les circonstances de la mort du forcené suscitent une controverse sur l'attitude de la police.
Brigade criminelle. 36, quai des Orfèvres, Paris. 9 h 30. Richard Durn, 33 ans, vient de remonter avec ses gardiens les trois étages de l'escalier monumental qui mène à l'enseigne lumineuse bleue de la «crim'». Au quatrième étage, sur la droite, une mezzanine et des filets tendus au-dessus du vide. Depuis qu'en 1984, Nathalie Ménigon d'Action directe a été rattrapée in extremis alors qu'elle enjambait la rambarde. Sur la gauche, un couloir étroit, au linoléum noir. On conduit Richard Durn dans le bureau 414 du groupe V. Au fond, sous le toit en soupente, deux tables de travail, une photo des Tontons flingueurs, un dessin de Corto Maltese, la une de l'Equipe sur la victoire des Bleus en 1998. Au milieu, à 1,60 mètre du sol, un vasistas clos mais non crocheté. Contre le mur de droite, la table du lieutenant Philippe D., qui a «le feeling» avec Richard Durn, qui a su le «mettre en confiance» et «le faire parler», selon un commissaire. On lui ôte les menottes. Une chaise lui est proposée face au policier blond, un café. Porte d'entrée verrouillée. On évite aussi le face-à-face «un contre un» entre le gardé à vue et «l'interrogateur», une habitude à la crim'. Un troisième homme reste «pour surveiller»: le brigadier Patrick M. Vissé à sa machine. Philippe D. attaque la troisième audition de Richard Durn, sur ses lettres (lire ci-contre). La veille, au bout de deux interrogatoires «chaotiques» et «décousus», il a fini par expliquer ce besoin de «maîtriser» pour une fois quelque chose, de «tuer le plus de gens possible» avant de s'«éliminer» lui-même. Au début de la garde à vue, à 1 h 30 du matin, «ce n'était pas gagné». «Terriblement excité» après ses huit meurtres, ceinturé, il hurle aux policiers: «Pourquoi vous ne m'avez pas tué ?» Quand l'officier lui notifie ses droits, «Durn refuse tout, ne veut ni médecin, ni avocat», explique un policier. «On l'envoie d'office à l'Hôtel-Dieu, où un généraliste l'examine et délivre un certificat médical: "état de santé compatible avec la garde à vue".» Prostré. Le procureur de la République de Nanterre, Yves Bot, et le patron de la brigade criminelle, Frédéric Pechenard, discutent. Faut-il l'envoyer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ? Le magistrat décide de ne «pas obérer la garde à vue», parce qu'il «faut un procès pour les familles, donc un dossier judiciaire et des explications de Durn». De plus, l'homme est désormais «prostré», «éteint», «calme». Au 414, Philippe D. parvient à «établir le contact» avec Durn, à lui extirper des phrases sur son curriculum vitae, sur ses problèmes psychiques («depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours vécu dans une prison mentale dont j'étais le propre geôlier», selon le procès-verbal), sur son impuissance à trouver un travail, sur sa mission humanitaire en Bosnie en 1993 («la seule aventure de ma vie»), sur son militantisme associatif («j'avais l'impression d'être pris pour un con»). Sur son geste aussi: «J'ai voulu connaître la griserie et le sentiment d'être libre par la mort.» Vers 19 heures, mercredi, l'officier D. tape la dernière phrase du procès-verbal de Richard Durn: «Je veux mourir car je suis une chose et un déchet.» Le gardé à vue signe et part pour la nuit au «dépôt», en sous-sol. Il est 19 h 30. Le commissaire Pechenard l'accompagne et «donne des instructions orales et écrites aux gardiens»: "Instable psychologiquement, Richard Durn est susceptible d'attenter à ses jours, et nécessite une attention de tous les instants."» Fusée. Hier matin, Durn revient dans le bureau 414 et parle à l'officier D. de ses lettres. Toujours «extrêmement calme et coopératif». Le policier le questionne sur l'ultime lettre à sa mère et lui demande de se lever pour regarder le document. Il est 10 h 15. «Richard Durn est parti comme une fusée en l'air, a pris appui sur un meuble, et a plongé sur le vasistas, comme d'un plongeoir mais en sens inverse, avec une force démentielle, comme s'il voulait percuter la vitre, passer à travers, rapporte un enquêteur. Sous la poussée, le vasistas a volé, le brigadier M. a plongé derrière, a essayé de le retenir par les jambes, et a failli y passer aussi, rattrapé par l'officier D. Comme on enlève les lacets des gardés à vue, M. s'est retrouvé avec la basket gauche de Durn à la main.» Les policiers diront plus tard: «On n'est pas à Guantanamo ici, on ne met pas des chaînes aux pieds des criminels.» Le corps a glissé sur le toit en pente sur 2 mètres, a passé la gouttière, et a chuté de quatre étages sur le bitume de la cour intérieure du «36». Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, a parlé de «graves dysfonctionnements» et déclenché une enquête conjointe avec la garde des Sceaux sur ce suicide. Les policiers de la crim' défilent à l'IGS, la police des polices, sommés de dérouler la garde à vue. L'enquête judiciaire sur les «assassinats» continue, donc l'action publique n'est pas éteinte.
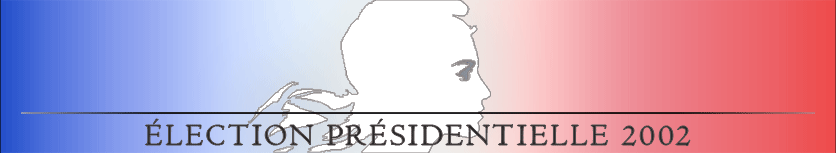






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire